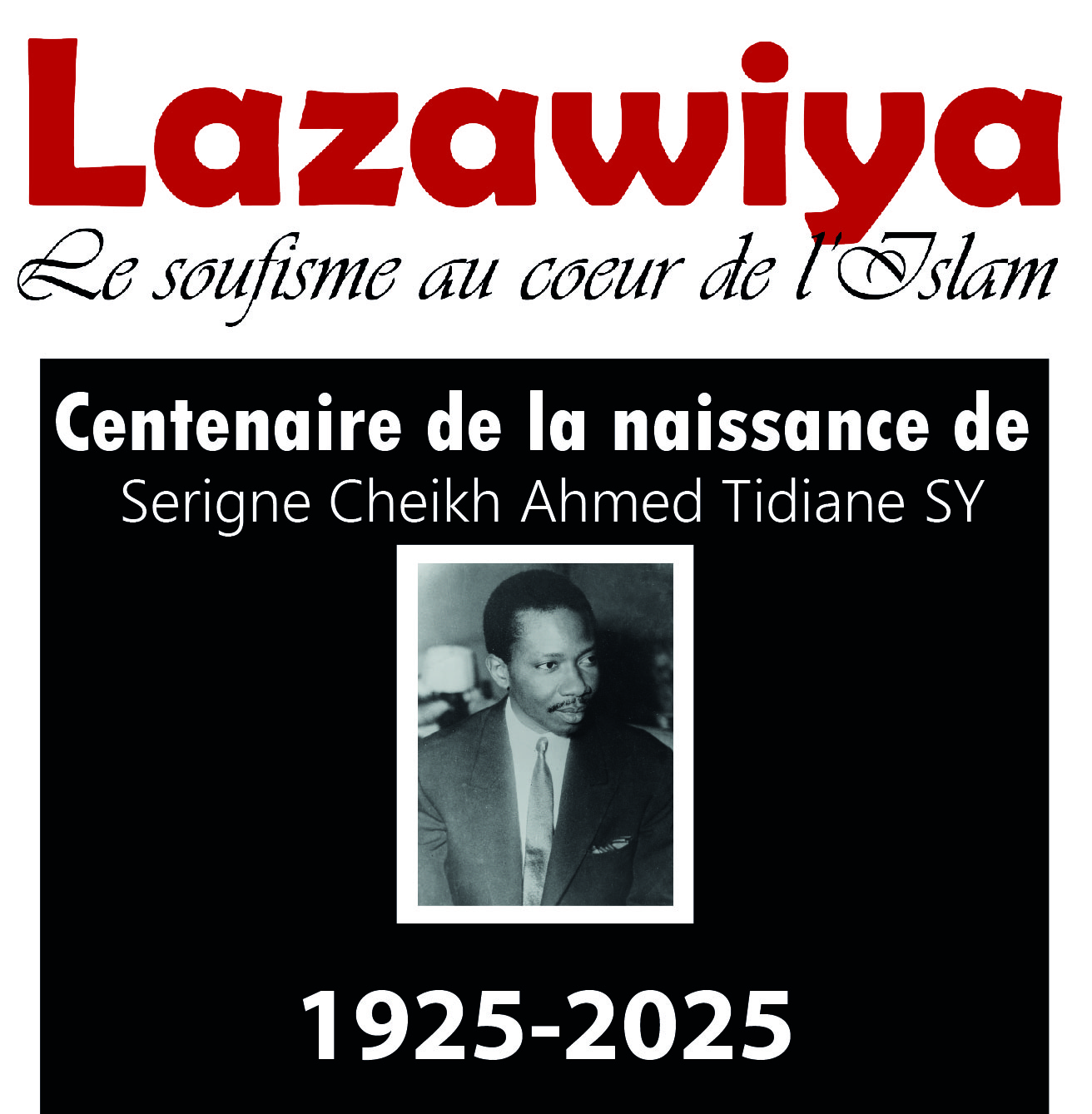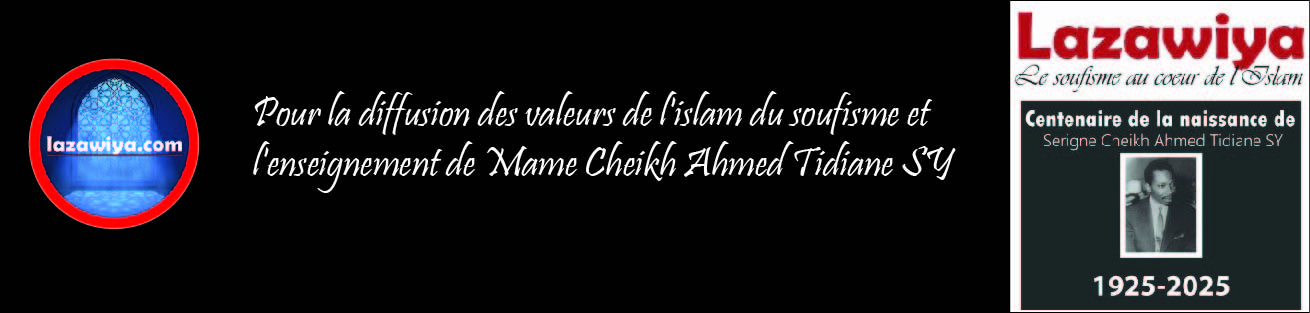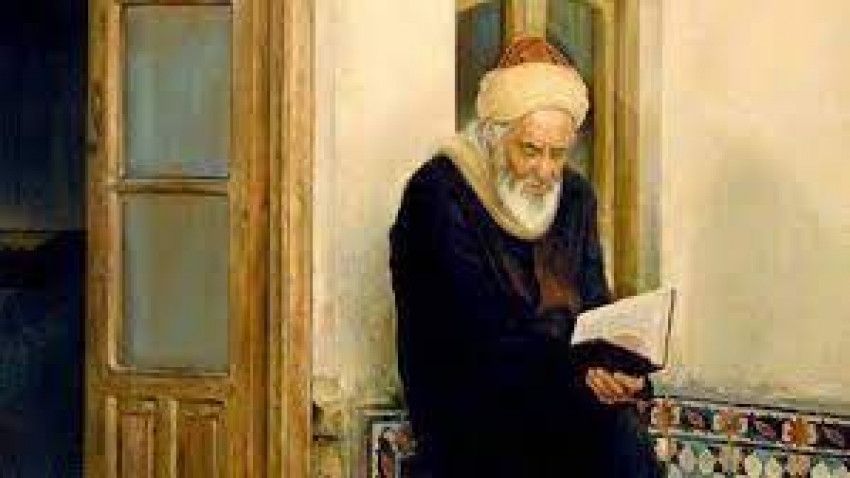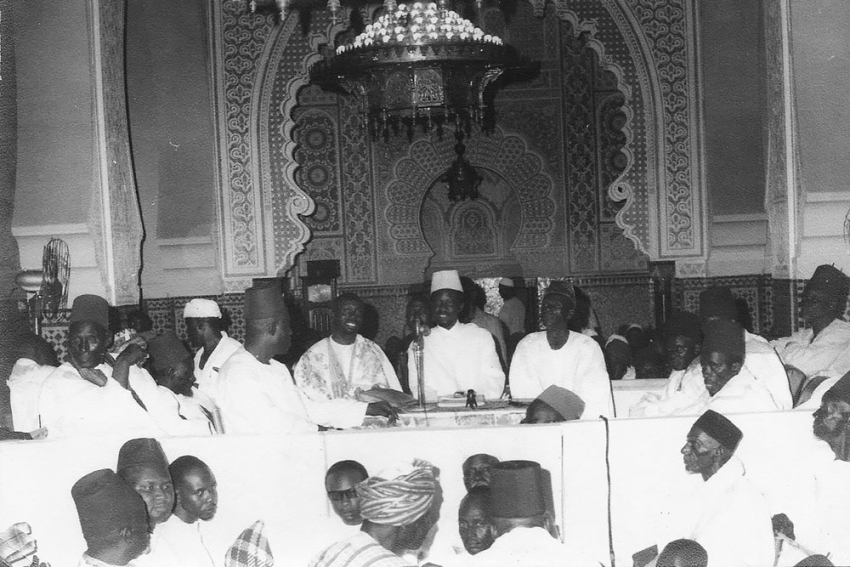consignée dans plus de cinquante ouvrages, dont les plus importants sont Ihya’ ‘Ulum al-Din [Vivification des sciences de la foi], Tahafut al-Falasifa [L’incohérence des philosophes] etAl-Munquidh min al-Dalal [Erreur et délivrance], ouvrages que l’on continue aujourd’hui à étudier ;
• Ses vues étaient en accord avec son époque et son milieu, reflétant cette époque sans doute plus qu’elles ne répondaient à ses besoins et à ses exigences, et constituant un élément de continuité et d’ordre plus qu’un facteur de renouveau et de changement ;
• Après lui, la société et la pensée islamiques sont ensuite entrées dans une longue ère de sclérose et de décadence, où les grands penseurs se sont faits rares, ce qui explique que la pensée d’al-Ghazali soit restée vivante et influente. L’influence d’al-Ghazali sur la pensée islamique peut être ramenée aux éléments ci-après :
• Retour du « principe de crainte » dans la pensée religieuse, et insistance sur l’existence
du Créateur siégeant au centre de l’existence humaine et régissant directement et
constamment le cours des choses (après que les soufis eurent défait le « principe
d’amour ») ;
• Introduction de certains principes de logique et de philosophie (nonobstant les attaques d’al-Ghazali contre ces disciplines) dans la jurisprudence et la théologie dogmatique ;
• Réconciliation entre la « charia » et le soufisme (entre les jurisconsultes et des soufis) et multiplication des confréries soufies ;
• Défense de l’islam sunnite contre la philosophie et le chiisme ;
• Affaiblissement de la philosophie et des sciences de la nature.
L’influence d’al-Ghazali s’est étendue au-delà du monde islamique pour s’exercer jusque sur la pensée européenne chrétienne. A la fin du XIe siècle et surtout au XIIe siècle de l’ère chrétienne, de nombreuses oeuvres arabes, de mathématiques, d’astronomie, de sciencesnaturelles, de chimie, de médecine, de philosophie et de théologie ont été traduites en latin, dont certaines oeuvres d’al-Ghazali, notamment, Ihya’ ‘Ulum al-Din [Vivification des sciences de la foi], Maqasid al-Falasifa [Les intentions des philosophes ] (que d’aucuns ont prise par erreur pour un exposé de la pensée d’al-Ghazali alors qu’il s’agissait d’une récapitulation des principes philosophiques en cours à l’époque), Tahafut al-Falasifa [ L’incohérence des philosophes] et Mizan al-’Amal [critère de l’action]. En outre, un certain nombre de savants européens connaissaient l’arabe et ont pu prendre directement connaissance des vues d’al-Ghazali, l’influence est très nettement perceptible chez de nombreux philosophes et savants du Moyen Âge et du début de l’ère moderne, particulièrement chez Thomas d’Aquin, Dante et David Hume. Thomas d’Aquin (1225-1274), dans sa Summa Theologiae [Somme théologique] doit beaucoup à al-Ghazli (notamment — à la Ihya’ ‘Ulum al-Din [Vivification des sciences de la foi] , à Kimiya-yi Sa’adat [L’alchimie du bonheur] Ar-Risala al-Laduniyya [La sagesse chez les créatures de Dieu » et au « Message divin ». Les écrits de Dante (1265-1321) révèlent clairement le pouvoir islamique d’ al-Ghazali et de Risalat al-Ghufran [Épître du pardon ] d’al-Maari. Et al-Ghazali a également exercé une influence sur Pascal (1623-1662), surtout en donnant la primauté à l’intuition sur la raison et les sens, et cette influence se fait sentir chez Hume (1711-1772), dans sa réfutation de la causalité. Il semble qu’al-Ghazali ait exercé une influence plus profonde sur la pensée juive que sur la théologie et la pensée chrétiennes. Nombreux en effet étaient les savants juifs du Moyen Age qui connaissaient parfaitement la langue arabe, et certaines oeuvres d’al-Ghazali ont été traduites en hébreu. Son livre Mizan al-’Amal [Critère de l’action], en particulier, a trouvé un public chez les juifs du Moyen Âge : il a été plusieurs fois traduit en hébreu, et même adapté, les versets du Coran étant remplacés par les mots de la Torah. Un des grands penseurs juifs qui ont subi l’influence d’al-Ghazali a été Maïmonide (en arabe : Musa Ibn Maimun ; en hévreu : Moshe ben Maimom [1135-1204], cette influence étant manifeste dans son Dalalat al Ha’irin
[Guide des égarés ], rédigé en arabe, l’une des oeuvres les plus importantes de la théologie juive médiévale. Les écrits d’al-Ghazali sur l’éducation représentent l’apogée de la pensée éducative dans la civilisation islamique. La conception de l’éducation qu’il a élaborée peut être considérée comme la construction la plus achevée dans ce domaine, définissant clairement les buts de l’éducation, traçant la route à suivre et exposant les moyens de parvenir au but recherché.
Al-Ghazali a exercé une influence évidente sur la pensée éducative islamique du VIe au XIIIe siècle de l’Hégire (du XIIe au XIXe siècle de l’ère chrétienne). On peut presque dire qu’à de rares exceptions près, les praticiens et les théoriciens de l’éducation n’ont rien fait d’autre que copier al-Ghazali et résumer ses vues et ses écrits. Il suffit pour le vérifier d’examiner quelques grands ouvrages consacrés à l’éducation qui sont parvenus jusqu’à nous :
• L’ouvrage d’al-Zarnuji (mort en 571 H), intitulé Ta’lim al-Muta’allim Tariq at-Ta-allum [Apprendre à l’élève la voie de l’apprentissage], est essentiellement une compilation d’extraits d’Ihya’ ‘Ulum al-Din [Vivification des sciences de la foi] et de Mizan al-’Amal [Critère de l’action] pratiquement recopiés tels quels, avec de rares ajouts, du reste mineurs. Cet ouvrage, qui se distingue par sa concision et son style simple et assez vivant, est considéré comme l’un des ouvrages pédagogiques qui ont connu la plus grande diffusion.
• L’influence indirecte d’al-Ghazali peut être décelée dans les écrits d’al-Tusi (mort en 672 H). Ce savant, qui fut l’un des plus importants du Moyen Âge, a composé une oeuvre immense et diverse comptant plus de cent titres, consacrée à la philosophie, à la logique, à la morale, aux mathématiques et à l’astronomie. Parmi ses ouvrages les plus importants consacrés à l’éducation, il convient de citer Alhlaq Nasiri [Éthique naziréenne] (en
persan) et Adab al-Muta’allimin [Les règles de conduite des élèves]. Le premier de ces ouvrages révèle l’influence de Tahdhib al-Akhlaq wa-Tathir al-A’Araq [La réforme des moeurs et la purification des races] d’Ibn Miskawayh et de la philosophie grecque, et le second n’est qu’un résumé de l’ouvrage (Ta’lim) d’al-Zarnuji, qui lui-même reprenait al-Ghazali70.
• De même, Ibn Jama’a (mort en 733 H), dans son ouvrage [Guide de l’auditeur et de l’orateur sur les règles de conduite du savant et de l’élève], montre qu’il est directement influencé par al-Ghazali, ainsi que par al-Zarnuji et al-Tusi (qui reprenaient al-Ghazali). L’ouvrage susmentionné de cet enseignant, prédicateur et juge, qui vécut en Égypte, en Palestine et au Levant, se caractérise par sa simplicité et sa construction, ainsi que par le recours à un grand nombre de hadith et autres citations et contes. Il aborde de manière traditionnelle les thèmes désormais courants de l’éducation islamique (vertus du savoir, règles de conduite du savant, du maître et de l’élève) et consacre un chapitre aux règles de conduite des hôtes des madaris (qui s’étaient multipliées à l’époque) et un autre à l’art d’utiliser les livres. • Quant à l’ouvrage d’Ibn-al-Haji al-’Abdari (mort en 737 H), intitulé Madkahal ash-Shar’
ash-Sharif [Introduction à la Loi sacrée], il est pratiquement coulé dans le même moule que Ihya’ ‘Ulum al-Din [Vivification des sciences de la foi], mais reflète la grande différence qu’il y a entre la civilisation islamique du Ve siècle de l’Hégire et celle du VIIIe siècle. L’auteur y cite souvent al-Ghazali et semble bien au fait de sa pensée et de ses écrits, généraux ou consacrés à l’éducation.
• Au Xe siècle de l’Hégire (XVIe siècle de l’ère chrétienne), il y a Ibn Hajar al-Haitami, auteur de Tahrir al-Maqal fi Adab wa-Ahkam wa-Fawa’id Yahtaju ilaiha Mu’addibu-l-Atfal [Libération du discours sur les règles de conduite et les qualités morales requises des éducateurs des enfants], égyptien qui a étudié et enseigné à Al-Azhar avant de s’installer près de La Mecque. Ses écrits, représentatifs de la pensée et de la littérature de l’époque ottomane, mettent l’accent sur l’enseignement dans les écoles primaires, la situation des maîtres et les règles qui doivent régir leur action. Il cite abondamment al-Ghazali et s’y réfère souvent. La quasi-totalité de la pensée éducative islamique (et en particulier sunnite) a suivi le chemin tracé par al-Ghazali, dont l’influence ininterrompue a survécu au déferlement de la modernité occidentale et à l’apparition de la civilisation arabe moderne contemporaine.
Le texte suivant est tiré de Perspectives : revue trimestrielle d’éducation comparée